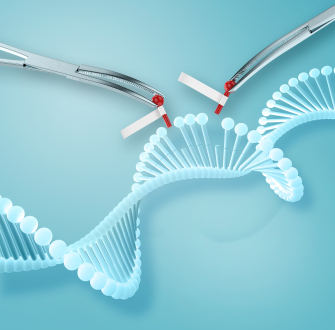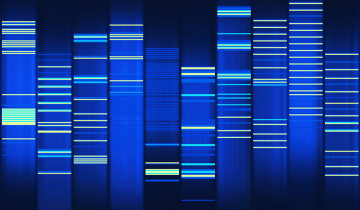Les plantes domestiquées forment la base de l’alimentation humaine. La manière de domestiquer les plantes a évolué au cours du temps, allant d’une sélection massale empirique depuis le Néolithique aux outils d’édition génomique actuels.
Qu’est-ce que la domestication ?
« Les races d’animaux domestiques et de plantes cultivées présentent souvent, comparées aux espèces naturelles, des caractères anormaux ou monstrueux ; c’est qu’en effet elles ont été modifiées, non pour leur propre avantage, mais pour celui de l’homme. »
La domestication des plantes correspond au processus évolutif au cours duquel leur culture et leur utilisation par les êtres humains a conduit progressivement à modifier les caractéristiques génétiques de certaines espèces végétales, jusqu’au point où les individus ne sont parfois plus capables de survivre et de se reproduire sans intervention humaine 1. Ce processus représente un événement majeur caractérisant les civilisations agricoles apparues il y a environ 10 000 ans, puisqu’il a permis l’accroissement démographique de l’humanité, inenvisageable sans ressources alimentaires importantes. Actuellement, les trois principales cultures céréalières (riz, blé et maïs) permettent de nourrir des milliards de personnes et fournissent, d’après l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 43 % des apports énergétiques alimentaires mondiaux.
Comparativement à leurs parents sauvages, les plantes domestiquées sont profondément et durablement modifiées dans leur morphologie, leur physiologie, leur génétique, sous une pression sélective qualifiée d’artificielle, c’est-à-dire appliquée par l’être humain (bien que les premiers caractères sélectionnés le furent certainement de façon inconsciente). Les caractères sélectionnés concernent essentiellement l’adaptation aux conditions de culture et de récolte des plantes : non-dispersion des graines à maturité, modification de taille, amélioration du rendement, augmentation du nombre de graines produit, précocité de la maturité, changement de couleur… 23 Lorsque des plantes sont cultivées au sein d’un agrosystème, l’allocation d’énergie disponible par plante se fait différemment : en raison de la concurrence interspécifique réduite, les ressources sont principalement redirigées vers une productivité plus élevée pour les organes récoltés. L’ensemble des caractéristiques qui distinguent la variété cultivée de son ancêtre sauvage constitue le « syndrome de domestication », d’après l’expression proposée par Karl Hammer en 1984 4. Il peut s’agir de l’acquisition de caractères intéressants et utiles pour l’Homme (fruits plus gros, plus sucrés…) ainsi que de la perte de certains caractères (production de composés toxiques), en particulier de ceux nécessaires à la survie de l’espèce en milieu sauvage (déhiscence des graines par exemple).
D’après les modèles actuels, regroupant des données génétiques, génomiques et archéologiques, la domestication peut être décrite comme un processus en plusieurs étapes 5 :
- début de la culture ;
- sélection d’allèles d’intérêt, soit préexistants à l’état sauvage ou apparus plus tard par mutation, et pouvant finir par se fixer dans les populations ;
- diffusion et formation de populations domestiquées adaptées aux conditions environnementales et aux usages locaux ;
- reproduction pouvant devenir en partie ou totalement dépendante de l’intervention humaine.
Histoire de la domestication
La domestication est à l’origine de la naissance de l’agriculture durant la révolution néolithique, qui correspond à la période de transition durant laquelle les chasseurs-cueilleurs sont progressivement devenus producteurs agricoles sédentaires.
On retrouve les premières traces de domestication datant de l’Holocène dans le Croissant fertile, mais également en Amérique centrale, dans les Andes, en Chine, en Nouvelle-Guinée ou en Afrique de l’Ouest 6789. C’est par exemple dans l’actuelle Jordanie, sur le site de Shubayqa, qu’ont été retrouvées les traces de la probable plus ancienne préparation alimentaire, une sorte de « galette de pain » contenant entre autres de la farine de graminées, et datant d’il y a plus de 14 000 ans. Selon un essai paru en 1926 et écrit par le botaniste russe Nikolaï Vavilov, les premiers centres de domestication correspondraient à huit zones de forte diversité génétique, c’est-à-dire des régions où il existe un grand nombre de variétés pour une même espèce, ou encore un grand nombre d’espèces appartenant au même genre 10. Par la suite, le botaniste américain Jack Harlan évoquera trois centres de diversité (Proche-Orient, Chine et Amérique centrale) adjoints à trois « zones périphériques » (noncenters) plus étendues au sein desquelles les variétés de plantes auraient été échangées 11. Actuellement, les scientifiques s’entendent sur l’existence d’une douzaine de centres de diversité, c’est-à-dire de régions du monde d’où sont issues plusieurs espèces de plantes domestiquées (Figure 1). Cependant, en dehors de ces zones, la majorité des populations agricoles ont contribué à la domestication d’une ou plusieurs espèces.
D'Ouest en Est :
- Mésoamérique (à partir de – 9 000 ans ; maïs, haricot, courge, coton, tabac, avocat, vanille)
- Est des États-Unis (à partir de – 4 000 ans ; tournesol, chénopode)
- Amazonie et Andes (à partir de – 6 000 ans ; patate douce, pomme de terre, manioc, coton, poivron, ananas, papaye, quinoa, tabac, cacahuète)
- Afrique de l’Ouest (à partir de – 3 000 ans : palmier à huile, igname)
- Sahel (à partir de – 5 000 ans ; sorgho, millet, riz africain)
- Éthiopie (à partir de – 3 000 ans ; café, teff, millet)
- Croissant Fertile (à partir de – 10 000 ans : orge, blé, lin, lentilles, fève, seigle)
- Asie du Sud-Est (à partir de – 6 000 ans ; fève, taro, igname, banane, canne à sucre, noix de coco)
- Chine (à partir de – 8 000 ans ; millet, riz, soja, chou)
- Nouvelle-Guinée (à partir de – 10 000 ; taro, banane, igname, canne à sucre)
Figure d’après Diamond, 2002 [9].
Aujourd’hui, le nombre d’espèces formant les plantes domestiquées est assez limité, même si leur importance est considérable : moins de 20 espèces apportent environ 95 % de l’apport calorique au niveau mondial. On estime que, sur environ 500 000 espèces d’Embryophytes existantes, environ 2500 ont été domestiquées à des degrés divers, et seulement 250 sont pleinement domestiquées 12. La majorité des plantes domestiquées appartient à quatre familles : les Poaceae (blé, riz, maïs, orge, canne à sucre, sorgho, millet), les Brassicaceae (colza, choux, navets…), les Rosaceae (majorité des arbres fruitiers) et les Fabaceae (soja, haricots, pois, pois chiches, lentilles) 3.
Il est relativement difficile de retracer l’histoire de la domestication de nombre de ces espèces, car les événements de domestication sont souvent multiples, et les échanges génétiques entre populations domestiquées et populations sauvages fréquents 456. Il existe également des espèces telles que la noix du Brésil ou l’espèce de riz Oryza nivara qui sont cultivées sans pour autant être domestiquées.
À quoi ressemble une plante domestiquée ?
Les objectifs principaux dans un agrosystème sont d’augmenter la biomasse à récolter, d’en faciliter la récolte et d’augmenter la résistance des cultures à certains facteurs abiotiques (mauvaises conditions climatiques) ou biotiques (maladies, parasites, insectes). Si plusieurs traits ont donc été sélectionnés en ce sens, une plante domestiquée ne les présente pas forcément tous, et le syndrome de domestication dépend à la fois de la plante, mais également du système de culture.
Les traits les plus fréquemment sélectionnés (mais non exclusifs) sont 7 :
-
L’autogamie (autofécondation) plutôt que l’allogamie (fécondation croisée) en cas de reproduction sexuée, et la multiplication végétative, ce qui permet de rendre l’épisode reproductif plus indépendant des conditions biotiques et abiotiques. On retrouve donc une plus grande proportion d’autogames dans les plantes domestiquées que dans les plantes sauvages, ce qui peut également être amplifié par le fait que les espèces autogames peuvent être plus simples à domestiquer que les allogames.
-
La moindre dispersion des graines, voire la disparition totale de l’égrenage, afin de limiter les pertes à la récolte. Souvent, les structures facilitant la dispersion disparaissent également : poils, crochets… Ces modifications rendent la propagation de la plante dépendante de l’intervention humaine.
-
Le port compact, permettant une récolte plus simple lorsque des plantes de taille similaire sont récoltées, comme chez les céréales. Ce trait peut être dû au raccourcissement des ramifications ou au tallage (un mode de multiplication végétative induisant la croissance de pousses secondaires à partir du collet de la plantule, dont le port se densifie alors).
-
La synchronisation, entre les individus de l'espèce cultivée, de la période de germination, de floraison ou de fructification, permettant une récolte facilitée. Pour ce faire, il est par exemple possible de sélectionner la perte de dormance des graines8. C’est ainsi que de nombreuses variétés cultivées possèdent des graines germant rapidement après la plantation ; la germination des graines est ainsi relativement synchrone.
-
La diversité de morphologies et de couleurs. On trouve de beaux exemples dans la famille des choux (Brassica sp.) : chou rouge, chou-fleur, chou romanesco, chou de Bruxelles, chou-rave… (Figure 2) ou des Rosaceae, une famille dont sont issus la majorité des fruits que nous consommons (pommes, poires, cerises, prunes…).
-
Une diminution de la quantité de composés toxiques permettant chez la plante sauvage la défense vis-à-vis des herbivores : il y a par exemple réduction des glucosides cyanogéniques chez l’igname ou le manioc 9.
-
Une modification de la quantité de composés à fort potentiel nutritif : équilibre sucre-amidon du maïs, qualité boulangère du blé…
À gauche figure un ensemble de variétés domestiquées à partir de l’espèce Brassica oleracea (à droite), dont le plus proche parent sauvage serait Brassica cretica, endémique des bords de la mer Égée [19]. Une grande diversité morphologique est ici illustrée par le chou rouge (Brassica oleracea var. capitata f. rubra), le chou romanesco (var. botrytis), le chou de Bruxelles (var. gemmifera), le brocoli (var. asparagoides), le chou pommé frisé (var. sabauda), le chou-fleur (var. botrytis) et le chou-rave (var. gongylodes). Ces différentes variétés sont le résultat de la sélection réalisée sur le développement des tiges, des feuilles entourant le bourgeon terminal, des bourgeons auxiliaires ou des inflorescences.
Crédits : Image de gauche : Coyau, CC-BY-SA, Wikimedia ; Image de droite : Kulac, CC-BY-SA, Wikimedia.
Certains de ces traits ont évolué parallèlement au sein d’espèces parfois éloignées, on parle de convergence évolutive. Dans certains cas, ils résultent d’une sélection effectuée sur des gènes communs à plusieurs familles. Ainsi, des études ont montré que la réduction de la dormance est due à la sélection parallèle d’orthologues du gène SGR chez le soja, le riz et Arabidopsis sp. 1, ou encore que l’amélioration de caractères des grains du riz (Oryza sativa), du sorgho (Sorgho bicolor), de l’orge (Hordeum vulgare) ou du millet (Pennisetum glaucum) est liée à différentes mutations chez les orthologues du gène Waxy 2. Ces cas d’évolution parallèle ne sont cependant pas la règle générale : par exemple, la surexpression du gène tb1 du maïs (Zea mays), permettant la réduction de la ramification chez cette espèce cultivée, n’a pas d’effets comparables sur son orthologue présent chez le millet des oiseaux (Setaria italica), chez qui il a été montré que la perte de la ramification serait plutôt due à des modifications de gènes intervenant dans la voie de biosynthèse de certaines phytohormones 34. Il existe de nombreux autres exemples qui montrent que la convergence des traits phénotypiques dans le syndrome de domestication est soutenue par des mécanismes à la fois communs et distincts. Les gènes de domestication codent majoritairement des facteurs de transcription ; de multiples études montrent que la domestication conduit à une reprogrammation transcriptionnelle majeure 5.
Comment domestiquer une plante ?
La sélection de variants alléliques dans un cadre de production alimentaire a souvent résulté d’un très lent processus impliquant la fixation de variations favorables apparues naturellement par mutation. Des données archéologiques ont par exemple montré que la fixation du caractère « égrenage réduit » chez le riz, le blé ou l’orge a nécessité plusieurs millénaires 67. La sélection à l’origine de cette fixation peut s’effectuer de façon involontaire, par le choix de certaines pratiques culturales ou la modification de l’environnement agricole, qui provoquent la modification des caractéristiques des plantes suite à leur changement d’habitat initié par l’être humain. La domestication est alors qualifiée d’indirecte.
La sélection artificielle est toutefois le plus souvent réalisée de façon consciente. Dans ce cas, l’espèce humaine favorise directement la reproduction de plantes présentant des caractères qu’elle cherche à valoriser et la fixation des caractères peut être plus rapide et ne nécessiter que quelques décennies.
Sélection massale
La sélection d’un trait d’intérêt est obtenue sur plusieurs générations par tri des produits issus de la reproduction (Figure 3). Pour des plantes se reproduisant par reproduction sexuée, des semis ou des graines sont choisis à chaque nouvelle saison de reproduction : c’est ce qu’on nomme sélection massale. Cette technique a longtemps été utilisée de façon empirique, reposant uniquement sur l’observation des conséquences d’une telle sélection, sans connaissance des mécanismes sous-jacents. Elle se fonde généralement sur des caractères facilement identifiables (taille, forme, couleur…). Génération après génération, cette sélection aboutit à des variétés cultivées très différentes des générations parentales sauvages, qui peuvent aboutir à une grande homogénéité (si la reproduction est autogame) ou au contraire à une variabilité génétique encore importante pour des caractères phénotypiques proches (« variétés populations » dans le cas d’une reproduction allogame). Tant qu’il reste un peu de reproduction par allofécondation au sein des populations, les brassages génétiques liés à la reproduction sexuée, se déroulant lors de la méiose et de la fécondation, ne permettent pas d’obtenir des populations parfaitement homogènes d’un point de vue génétique. Pour les plantes se reproduisant de façon végétative (reproduction asexuée), la sélection à chaque nouvel événement de reproduction concerne des boutures ou des greffons par exemple, autrement dit des clones. Les caractères avantageux apparus suite à des mutations ou des croisements sont fixés, car non soumis à la ségrégation génétique ayant lieu en cas de reproduction sexuée.
Depuis l’Antiquité, les agriculteurs trient les plantes les plus performantes (résistance aux maladies, aux intempéries, meilleure productivité…) puis choisissent les semences de l’année suivantes parmi ces « meilleurs » individus. Cette sélection artificielle modifie très lentement les caractéristiques génétiques de la population initiale, sans jamais les uniformiser complètement. Via cette méthode, appliquée localement dans différentes conditions environnementales et de culture, une immense diversité de variétés dites « de pays » a été obtenue.
La sélection assistée par marqueurs et la sélection génomique
La sélection massale repose sur l’idée que sélectionner les parents présentant les phénotypes les plus avantageux aboutira à des descendants présentant également les meilleurs phénotypes possibles. Si cela peut effectivement être le cas pour des plantes propagées de manière asexuée, où les descendants sont donc des clones des parents, ce n’est pas vrai en cas de descendants obtenus par reproduction sexuée de deux plants parentaux. En effet, les événements de méiose et de fécondation qui caractérisent la reproduction sexuée impliquent un brassage génétique : les descendants ne possèdent pas les mêmes combinaisons d’allèles que leurs parents. Ainsi, les associations alléliques avantageuses présentes chez des parents aux phénotypes intéressants peuvent être perdues chez les descendants, qui présentent alors des phénotypes moins bons qu’espérés. D’autres raisons peuvent expliquer que les descendants présentent de moins bons phénotypes que leurs parents ; celles-ci sont détaillées dans un article appliqué à un exemple animal, celui des vaches laitières.
Pour contourner cette limite de la sélection massale, des méthodes plus récentes de sélection cherchent à associer les phénotypes des individus à leurs génotypes. Ainsi, en génotypant un individu aux performances inconnues, il est possible de prédire ses performances. Dans un premier temps, ce type de sélection s’est fait grâce au génotypage de marqueurs génétiques situés à proximité de gènes d’intérêts connus ou de QTL (quantitative trait locus ou, en français, locus de trait quantitatif), des régions du génome associées à des caractères quantitatifs, c’est-à-dire des caractères présentant une variation continue et mesurable au sein d’une population (masse des graines, nombre de graines…).
Cette sélection assistée par marqueurs est de plus en plus remplacée par la sélection génomique. Le principe de celle-ci est d’utiliser des populations de référence dans lesquelles les phénotypes des individus sont mesurés et leurs génotypes déterminés sur un grand nombre de marqueurs répartis sur tout le génome. Cette étape permet de constituer des associations statistiques entre tels marqueurs et tels phénotypes, sans avoir besoin d’identifier précisément les gènes ou régions du génome à l’origine des phénotypes, c’est-à-dire sans comprendre les mécanismes à l’origine des phénotypes. Une fois ces associations entre génotypes et phénotypes connues sur les populations de référence, il est possible, en déterminant le génotype d’un individu aux performances inconnues, de prédire son phénotype. Le principe de la sélection génomique est présenté plus en détails dans un article appliqué à l’exemple des vaches laitières.
Croisement de plants d’intérêt
À partir du début du XXe siècle et de façon moins hasardeuse qu'avec la sélection massale, la création de nouvelles variétés est également réalisée par croisement entre deux individus. Ils peuvent appartenir à la même espèce – le croisement intraspécifique exploite alors la variabilité intraspécifique – ou à deux espèces différentes : le croisement est interspécifique.
La stratégie de croisement diffère selon que l’on a affaire à une espèce autogame, comme le blé, ou à une espèce allogame, comme le maïs. En effet, chez une espèce autogame, la dépression de consanguinité est faible, ce qui veut dire que les plantes restent productives même si tous leurs locus sont à l’état homozygote (cas d'une lignée pure). À l’inverse, chez les plantes allogames, la dépression de consanguinité est marquée : les lignées pures sont peu productives.
Chez les espèces autogames, l’obtention de plantes présentant des caractères d’intérêt peut donc suivre le schéma suivant :
-
Les plants parentaux sont sélectionnés pour leurs caractères d’intérêt, par exemple la production de gros fruits chez l’un des parents et la résistance au gel chez l’autre. Cette sélection s’effectue dans une population initiale présentant des phénotypes variés : il peut s’agir de variétés anciennes ou de populations sauvages. Ces plants parentaux présentent généralement une certaine hétérozygotie.
-
Le croisement des plants parentaux permet d’obtenir des individus F1 dont certains combinent les caractères d’intérêt des deux parents, dans notre exemple la production de gros fruits et la résistance au gel.
-
Ces individus F1 d’intérêt sont utilisés pour produire une génération F2 par autofécondation.
-
Au sein de la génération F2, les individus présentant les caractères d’intérêt sont reproduits par autofécondation, puis leurs descendants également, et ainsi de suite sur environ sept générations. Ces autofécondations successives permettent d’augmenter progressivement le degré d’homozygotie jusqu’à obtenir une lignée pure, homozygote pour l’ensemble de ses locus.
-
Ces lignées pures peuvent ensuite être utilisées en production et leurs graines peuvent être resemées d’une année sur l’autre.
Il est également possible de procéder de la sorte pour obtenir des lignées pures chez les espèces allogames, mais ces lignées seront alors peu productives, à cause de la forte homozygotie. La stratégie optimale consiste dans ce cas à croiser deux lignées pures peu productives pour obtenir une lignée F1 productive, grâce à l’hétérozygotie introduite par le croisement des deux lignées. Cette meilleure productivité de l’hybride F1 par rapport aux parents est appelée vigueur hybride, ou hétérosis. Par contre, il n’est pas idéal de planter les graines produites par la génération F1 à la saison suivante, car cette génération F2 aura perdu 50 % de son hétérozygotie par rapport à la génération F1. Chez les plantes allogames, il est donc nécessaire de replanter chaque année des semences hybrides F1.
Grâce à des autofécondations successives (fécondation d’un ovule par du pollen issu de la même plante, réalisée de façon manuelle), on obtient des lignées pures homozygotes pour tous les gènes. Chez les espèces allogames, comme c’est le cas ici pour le maïs, les lignées pures sont généralement moins performantes que des individus présentant un taux d’hétérozygotie élevé. C’est pourquoi, une fois obtenues, ces lignées pures sont généralement utilisées pour produire des hybrides (processus non représenté sur ce schéma). L’hybridation consiste à réintroduire de l’hétérozygotie en croisant deux lignées pures (hybridation simple), ce qui engendre une génération F1. La génération F1 présente des caractéristiques homogènes et un gain de vigueur par rapport aux deux parents, qui est nommé hétérosis.
L’apport des biotechnologies
Les récentes avancées dans la compréhension et la manipulation des génomes de plantes (lecture, interprétation mais également édition) permettent d’accélérer le rythme de l'amélioration variétale. En effet, de nombreux génomes de plantes cultivées (maïs, blé, pomme de terre, coton… 1234) sont maintenant séquencés complètement, grâce à des techniques de séquençage de plus en plus performantes permettant de lire de longues séquences (> 10 kb pour le séquençage de troisième génération TGS) et des outils d’assemblage de génome limitant les lacunes 5678. Cette connaissance de plus en plus approfondie des génomes d’intérêt permet leur interprétation, puis leur modification grâce à des techniques d’édition, qui se révèlent être de puissants outils de création de nouveaux allèles pour les gènes cibles de la sélection végétale.
Transfert d’allèles d’intérêt
Grâce à la transgénèse pratiquée depuis la fin du XXe siècle, il est possible d’intégrer des gènes issus d’une espèce dans le génome d’un individu d’une autre espèce. Dans un premier temps, les caractères intéressants, ainsi que les protéines qui en sont responsables sont identifiés, et les gènes codant ces protéines sont isolés.
Par la suite, la transgenèse peut se réaliser de manière indirecte, par transformation biologique à l’aide de la bactérie Agrobacterium tumefasciens. Dans ce cas, le gène d’intérêt est introduit, à l’aide d’enzymes de restriction, dans un plasmide bactérien qui sert de vecteur. A. tumefasciens est ensuite mise en contact avec des cellules végétales et va leur transférer le plasmide. Le gène d’intérêt peut alors s’intégrer dans l’ADN du végétal cible (Figure 5).
La transgenèse peut également être directe lorsque l’ADN d’intérêt est projeté directement dans les cellules de la plante à l’aide de microparticules de métal sur lesquelles il est fixé, ou quand l’ADN est intégré à des protoplastes grâce à un agent chimique ou à un choc électrique (électroporation).
La commercialisation des plantes génétiquement modifiées (PGM) a débuté en 1996, et leur culture concernait, en 2019, 11,3 % des surfaces cultivées dans le monde (essentiellement du soja, du coton, du colza et du maïs-grain).
La technique décrite ci-dessus est pratiquée depuis le XXe siècle et reste la plus couramment utilisée. Elle implique l’utilisation d’une bactérie du sol, Agrobacterium tumefasciens, qui réalise naturellement la transformation génétique de la plante au cours du processus de parasitage. En laboratoire, cette bactérie est d’abord rendue avirulente avant utilisation.
Modification d’allèles d’intérêt par édition génomique
D’autres techniques complémentaires à la transgenèse existent, permettant d’éditer le génome d’une plante pour y insérer des allèles d’intérêt qui en seraient absents ou pour modifier l’expression d’allèles existants.
Grâce à la technologie des « ciseaux moléculaires » CRISPR-Cas9, il est possible de modifier ou d’insérer des allèles au sein d’un génome existant. Par complémentarité entre la séquence d’ADN ciblée et un ARN guide puis cassure enzymatique de la double hélice, des séquences d’ADN exogènes sont insérées dans le génome de la plante. Ces insertions ponctuelles peuvent par exemple provoquer un décalage de cadre de lecture dans la région codante du gène d’intérêt, qui se retrouve donc inactivé (knock-out) à l’échelle de l’organisme 1.
Si ce type de mutation provoquée peut s’avérer utile pour valider la fonction des gènes, elle n’est cependant pas toujours idéale pour l’amélioration génétique car de nombreuses mutations de domestication sont plutôt du type « allèle faible » ou « allèle quantitatif », correspondant à la réduction ou à l’augmentation d’un trait phénotypique, mais pas à sa disparition ou son apparition totales. Par exemple, la plupart des variétés cultivées de riz contiennent sh4, un allèle muté (substitution d’un G en T dans l’exon 1) dont l’expression réduit la déhiscence du rachis et permet donc le maintien provisoire de la graine sur l’épi, trait favorable à la récolte. Il a été montré qu’un changement de cadre de lecture dans ce même allèle éliminait complètement le développement des zones de déhiscence, ce qui n’est pas l’effet recherché car les graines seraient alors indissociables de l’épi 2. Aussi, pour modifier subtilement l’expression d’un trait phénotypique, il peut donc être nécessaire d’avoir recours à des mutations modifiant légèrement la fonction de la protéine codée ou l’intensité de son expression, plutôt qu’à des mutations empêchant complètement l’expression de la protéine.
Un autre exemple de modification quantitative de traits d’intérêt se trouve chez le riz. La création de nouveaux allèles du gène Waxy, codant une enzyme de synthèse de l’amidon, a permis d’ajuster précisément le contenu en amidon des grains, et donc de produire des variétés de riz plus ou moins gluant après cuisson 3. Il est également courant de modifier les régions promotrices en amont des gènes d’intérêt afin d’influencer leur expression, comme dans le cas de la taille des fruits chez la tomate qui dépend de traits quantitatifs 4.
Enfin, l’édition du génome peut être réalisée via des délétions plus ou moins importantes de séquences complètes. Chez le blé, un compromis entre résistance à l’oïdium et rendement a été obtenu pour certaines variétés grâce à une délétion ciblée de 304 kb dans le locus O du gène TaMLO1, dont l’inactivation totale engendre une forte résistance à l’oïdium mais des défauts de croissance rédhibitoires 5.
Ces techniques permettant l’obtention d’organismes génétiquement modifiés (OGM) sont soumises à une réglementation européenne en pleine évolution, comme détaillé dans cette conférence portant sur les nouvelles technologies de modification du génome des plantes.
Conséquences de la domestication
À l’échelle de l’espèce domestiquée
Au sein de l’espèce sur laquelle le travail de sélection artificielle est réalisé, de nombreuses variétés sont créées à partir d’une même plante sauvage initiale. Une variété désigne un rang taxonomique inférieur à celui de l’espèce (rang de la sous-espèce ou inférieur), regroupant des individus qui peuvent différer légèrement des autres individus de la même espèce par un ou plusieurs caractères qualifiés de « mineurs », et étant toujours interfertiles, ne justifiant pas l’appartenance à une nouvelle espèce distincte. Ces variétés sont généralement très proches génétiquement, car issues de la sélection de mutations de seulement quelques gènes particuliers. Par exemple, la grande diversité des variétés de maïs (espèce Zea mays) permet une grande diversité d’utilisations de cette Poacée, en fonction des caractéristiques présentées par le grain. Parmi les variétés existantes, citons le maïs denté (Zea mays indentata) dont l’albumen farineux en fait le maïs le plus cultivé au monde, le maïs corné (Zea mays indurata) dont l’albumen est plus vitreux (c’est-à-dire plus riche en protéines) et le rend utilisable dans l’industrie semoulière, mais également le maïs doux (Zea mays saccharata) destiné à l’alimentation humaine ou encore le maïs pop-corn (Zea mays everta)…
De façon encore plus variée, derrière le nom commun « blé » figurent en réalité plus de vingt espèces et sous-espèces du genre Triticum, plus ou moins populaires selon leur utilisation. Le cas du blé illustre l’utilisation par l’Homme de différentes variétés, cette fois obtenues à partir d’au moins trois espèces différentes du genre Triticum. Si on connaît très bien les sous-espèces les plus courantes telles que le blé tendre (Triticum aestivum subsp. aestivum), largement répandu et qui permet la fabrication de nombreuses pâtisseries, ou le blé dur (Triticum turgidum subsp. durum) qui est à l’origine des pâtes et des semoules, des sous-espèces plus anciennes comme l’amidonnier (Triticum turgidum subsp. dicoccum), l’engrain (Triticum monococcum subsp. monococcum) ou encore l’épeautre (Triticum aestivum subsp. spelta) sont généralement moins connues car cultivées dans des zones plus restreintes. Les trois espèces à l’origine des différentes variétés de blé présentent une ploïdie différente : l’engrain (T. monococcum) est diploïde, le blé dur (T. turgidum) est allotétraploïde car issu de l’hybridation entre Triticum urartu et Aegilops speltoides suivie d’une duplication du génome ; le blé tendre (T. aestivum) est hexaploïde car issu d’une hybridation entre blé dur et Aegilops tauschii.
Si l’existence de sous-espèces permet une certaine biodiversité intraspécifique, la diversité génétique des plantes cultivées est tout de même globalement plus faible que celle de leurs parents sauvages. Lors de la domestication, seulement un sous-échantillon de la diversité sauvage a été utilisée, conduisant à un premier goulot d’étranglement. Par la suite, la sélection a conduit à ne conserver que certains phénotypes (et donc génotypes) d’intérêt, engendrant une perte de biodiversité génétique. La sélection récente a encore amplifié ce processus en ne produisant qu’un nombre limité de variétés dites élites, cultivées sur de très grandes surfaces. Cette perte de diversité réduit le potentiel adaptatif aux changements environnementaux : il n’existe plus ou peu de variants génétiques résistants aux ravageurs et aux maladies qui pourraient être sélectionnés en réponse à ces pressions environnementales. Cette perte de biodiversité génétique, finalement liée à une diminution du nombre de variétés existantes, a encore été accentuée après la Seconde Guerre mondiale, dès lors qu’une autorisation administrative devint nécessaire afin de commercialiser les nouvelles variétés. Dès 1964, les « lignées pures modernes », très homogènes génétiquement, deviennent les seules variétés cultivées et autorisées à la commercialisation. Cependant, une loi édictée en 2021 permet de mettre un terme au monopole des entreprises semencières, en permettant la commercialisation des semences paysannes en dehors du catalogue officiel, ce qui était interdit jusqu’alors.
De nombreuses plantes cultivées présentent un génome polyploïde, c’est-à-dire formé de plus de deux lots complets de chromosomes 678. Les événements de polyploïdisation, en augmentant la plasticité adaptative des plantes, semblent donc liés à une domestication réussie 91011. Une méta-analyse récente réalisée sur une douzaine de genres suppose que les espèces polyploïdes sont plus susceptibles d’être domestiquées que leurs parents sauvages : ainsi, on peut faire l’hypothèse que les conséquences génétiques de la polyploïdie auraient fourni un terrain préalable bénéfique à la domestication, plutôt que de considérer la polyploïdie comme une conséquence de la domestication 12131415.
Enfin, il a été montré que les plantes cultivées subissent de profondes modifications du métabolisme, qui semblent être assez spécifiques à chaque espèce 16. Par exemple, les changements morphologiques induits chez certaines variétés comme la tomate ou la laitue ont conduit, probablement par sélection involontaire de gènes liés, à une réduction de la concentration en composés toxiques (alcaloïdes) ou à des modifications de la concentration en acides aminés (malate, glutamate, proline, aspartate…).
À l’échelle de l’agrosystème
La croissance démographique est permise par une augmentation permanente de la production agricole via deux voies : l’augmentation des surfaces cultivées et l’augmentation des rendements des cultures. Depuis 1961, les surfaces cultivées mondialement ont augmenté de 12 %, alors que la production agricole mondiale a été multipliée par trois (FAO, 2011) : c’est donc essentiellement l’augmentation des rendements qui a permis de suivre l’accroissement démographique. Elle a notamment été permise par l’utilisation de variétés de plus en plus productives (Figure 6), mais également par l’évolution des pratiques agricoles (notamment l’utilisation d’engrais). Cependant, on observe depuis une quinzaine d’années une stagnation des rendements et un ralentissement de l’augmentation de la production mondiale. Les hauts rendements atteints grâce à des pratiques culturales de plus en plus spécifiques, liés à l’utilisation de plantes de plus en plus productives, ne s’obtiennent que grâce à des pratiques financièrement et écologiquement coûteuses, et peu généralisables.
Entre 1866 et 1936, les graines semées présentent des taux d’homozygotie variables, elles sont issues de la fécondation croisée entre deux variétés sélectionnées précédemment pour leurs caractéristiques intéressantes (en jaune). Durant la période 1937-1955, des hybrides doubles sont commercialisés et utilisés. Ils proviennent du croisement entre deux hybrides simples, eux-mêmes issus du croisement entre deux lignées pures. Cependant, ces hybrides doubles se révèlent moins performants que les hybrides simples et sont peu à peu retirés de la commercialisation. À partir de 1956, les forts gains de rendement sont générés par l’utilisation d’hybrides simples, de manière à maximiser l’effet d’hétérosis, mais également par l’utilisation de plus en plus importante de produits phytosanitaires et d’engrais.
Il est également nécessaire de développer d’autres pratiques culturales spécifiques pour pallier les maladies infectieuses (comme l’ont prouvé la famine ayant fait suite à l’infection des plantations de pommes de terre par le mildiou après 1845 en Irlande, ou l’infection virale touchant les bananiers, endémique dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne). La perte de diversité génétique liée à la domestication provoque une augmentation de la sensibilité aux pathogènes de certaines variétés (diminution des défenses chimiques, des capacités de dissémination, de la production de cuticules, de toxines ou encore d’épines). Dans le cas du blé tendre par exemple, il n’existe aucune variété parfaitement résistante aux champignons parasites de ces cultures (oïdium, septoriose, rouilles jaune ou brune). Le recours aux fongicides a atteint ses limites, car il sélectionne les champignons résistants, ce qui entraîne à terme une baisse d’efficacité des fongicides. Cependant, il a été démontré que l’association de plusieurs variétés de blé tendre sur la même parcelle permet de limiter la baisse de rendement consécutive à une infestation fongique. Cette pratique culturale permet un effet dilution (les plants sensibles sont plus éloignés les uns des autres, ce qui limite la propagation des pathogènes), un effet barrière (les plants résistants font obstacle entre les plants sensibles et piègent les pathogènes) et un effet prémunition (les plants résistants abritant divers pathogènes peuvent déclencher chez les sensibles des défenses réactivées ultérieurement). Une autre approche prometteuse est la culture d’espèces en mélange, par exemple céréales et légumineuses, permettant de limiter les maladies mais aussi d’améliorer la qualité des sols et de limiter les apports d’engrais.
Sur la relation Homme-espèce domestiquée
Les plantes domestiquées sont pour la plupart incapables de se développer seules dans les conditions naturelles : elles sont devenues dépendantes de l’espèce humaine pour leur survie, leur reproduction et l’occupation de nouveaux milieux. L’être humain est quant à lui dépendant des cultures végétales pour son alimentation. La domestication des espèces végétales est donc à l’origine d’une relation d’interdépendance entre les populations humaines et certains types de plantes, qui est parfois qualifiée de coévolution. En effet, il a par exemple été démontré que le régime alimentaire des populations humaines exerce une pression de sélection sur certains génotypes : ainsi, les individus possédant un allèle muté codant une enzyme permettant la synthèse des oméga-3 et oméga-6 à partir des légumes et graines ingérés seraient favorablement sélectionnés au sein des populations ayant un régime essentiellement végétarien 1. D’autres études ont montré l’impact probable de la domestication sur l’augmentation du nombre de copies d’un gène codant l’amylase salivaire responsable de l’hydrolyse de l’amidon 2.
Domestication des plantes et domestication des animaux
La domestication des plantes a parfois engendré celle de certaines espèces animales également. Ainsi, les premiers stockages de graminées effectués il y a 14 000 ans ont attiré au plus proche des humains des souris en quête de nourriture, puis rapidement leur ennemi habituel, le chat. Les humains ont donc vu un intérêt à ne pas chasser les félins, et une relation mutualiste entre eux s’est rapidement développée, au point que les chats deviennent sacrés dans certaines cultures.
Envisager le futur ?
En 2050, la population humaine devrait atteindre environ dix milliards d’individus. La nécessité d’augmenter la production agricole permettant de répondre à cette hausse démographique se heurte à l’urbanisation croissante, à la dégradation des sols et au changement climatique, qui devraient accroître les inégalités d’accès à l’eau potable et provoquer une baisse des rendements agricoles. De plus, l’utilisation des pesticides suscite de nombreuses interrogations quant à leurs effets sur la santé des écosystèmes (et des humains qui y habitent). L’enjeu actuel est donc de trouver des solutions permettant le maintien d’une agriculture suffisamment productive et résistante, qui respecte les sols et le reste des écosystèmes, primordiaux à sa pérennité. Par exemple, des associations variétales à l’échelle de la parcelle ou même du plant grâce au greffage (réalisé sur de nombreuses espèces maraîchères comme l’aubergine, la courgette ou la tomate, mais également sur la vigne depuis la crise du phylloxera), permettent de réintroduire de la diversité génétique primordiale au maintien d’un écosystème équilibré. C’est également le cas grâce à des rétrocroisements entre variété cultivée et espèce sauvage de façon à réintroduire des gènes de résistance partielle ou totale (exemple chez la pomme domestiquée Malus domestica, rétrocroisée avec Malus floribunda de façon à bénéficier d’un gène de résistance à la tavelure). Enfin, les avancées technologiques récentes ont fait émerger la possibilité d’une redomestication (ou domestication de novo), visant à élaborer des plants cultivés « idéaux » à partir d’espèces sauvages grâce à une manipulation génétique précise et bien plus rapide que la sélection phénotypique 12.