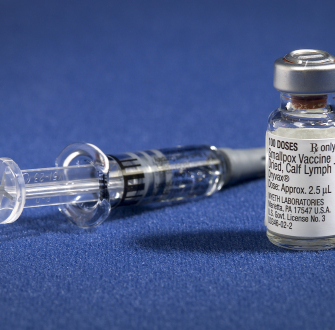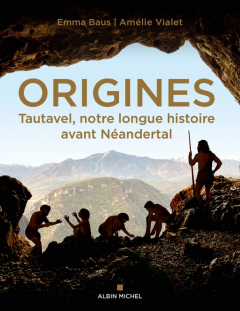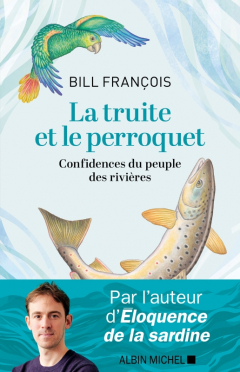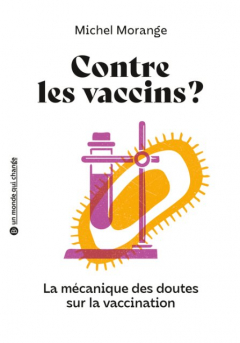Court, mais instructif, ce livre permet de mieux comprendre ce que sont les vaccins et pourquoi ils suscitent la méfiance d’une partie de la population.
Pour ou contre les vaccins ? Si cette question a refait surface au moment de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, elle existe depuis la découverte du premier vaccin contre la variole et ressurgit régulièrement sous différentes variantes. Les chiffres sont pourtant parlants : les vaccins permettent une diminution drastique du nombre de cas de nombreuses maladies, autrefois mortelles. Mais que répondre face aux cas, certes rares, de patients développant des effets secondaires ? Comment faire comprendre le bénéfice que pourrait apporter un vaccin protégeant contre une maladie qui ne nous affectera peut-être jamais ?
C’est en surfant sur ces peurs que se sont fait entendre des oppositions vaccinales, causes de la persistance voire de la résurgence de maladies et posant un véritable problème de santé publique, à l’échelle mondiale. Les moyens de communication actuels et notamment les réseaux sociaux représentent une caisse de résonance particulièrement efficace, relayant données falsifiées ou partielles, au mépris de toute méthode scientifique, afin de créer le doute chez les parents, les patients. Qui croire finalement ? Avoir fait des études de médecine ou de biologie ne semble pas être un critère puisque des opposants à la vaccination sont diplômés dans ces sciences. Pour bien comprendre les doutes et critiques, les avantages et les risques de la pratique vaccinale, il faut des faits précis (et non réfutés par la communauté scientifique dans son ensemble). C’est le but de cet ouvrage : présenter les découvertes dans leurs contextes historiques, l’acquisition progressive des connaissances en microbiologie, virologie et immunologie et la compréhension des découvertes empiriques afin d’améliorer la confection des vaccins, mais également discuter des doutes, des erreurs commises et des mesures prises pour ne pas les répéter et ainsi rendre ces mesures prophylactiques à la fois plus sûres et plus efficaces. C’est ainsi que ce livre vient compléter les apports de deux autres livres à recommander sur le sujet : Antivax de Françoise Salvadori et Laurent-Henri Vignaud et L’aventure des vaccins d’Anne-Marie Moulin.
Qui de mieux que Michel Morange pour aborder ce sujet ? Ancien directeur du Centre Cavailles d’histoire et de philosophie des sciences de l’École normale supérieure, biographe de Louis Pasteur et auteur notamment d’ouvrages sur l’histoire de la biologie moléculaire, ce professeur érudit a voulu mettre ses connaissances au service du lecteur afin de dresser un bilan précis de la pratique vaccinale, des balbutiements aux progrès actuels. Ces derniers sont mis en parallèle avec les autres avancées médicales (anesthésie, asepsie, chimiothérapie, pharmacologie), qui collectivement permettent d’améliorer la lutte contre les agents pathogènes, de mieux en mieux connus. Ce livre est ainsi découpé en quatre parties.
Dans le premier chapitre, Michel Morange nous fait remonter le temps vers les tâtonnements à l’origine de la grande épopée vaccinale : de la variolisation à la vaccination, avec les apports d’Edward Jenner, de Louis Pasteur et de Robert Koch. Ces avancées médicales furent dans un premier temps empiriques, puisque le mécanisme par lequel le système immunitaire est impliqué dans la vaccination n’était pas connu à cette époque.
Dans le second chapitre, l’auteur nous entraîne dans la frénésie des découvertes vaccinales du début du XXe siècle. À l’encontre du célèbre proverbe qui va piano va sano, la précipitation dans la conception de nouveaux vaccins comme ceux contre le choléra, la tuberculose, la fièvre jaune ou la poliomyélite ne s’est pas faite sans impasses, tâtonnements et parfois accidents médicaux liés à la méconnaissance du fonctionnement du système immunitaire. Les premiers adjuvants sont utilisés dans les vaccins à anatoxines. Parallèlement, les découvertes médicales progressent : les antibiotiques sont découverts, avec leurs effets curatifs immédiats, des armes chimiques utilisées lors des conflits mondiaux ont trouvé d’autres applications comme agents anticancéreux. Dans la guerre contre les pathogènes, la recherche avance.
Le troisième chapitre aborde la « révolution moléculaire » alors que les connaissances en immunologie, comme système de défense de l’organisme, s’incrémentent : compréhension de la diversité des anticorps, de l’origine et des spécificités des lymphocytes T. Si les vaccins à ADN n’ont pas été aussi efficaces qu’espérés, les progrès ont été plus satisfaisants sur les vaccins à ARN, notamment dans les thérapies anticancéreuses. La pandémie de Covid-19 a mis ces vaccins en lumière puisque c’est la stratégie qui s’est avérée efficace pour vacciner contre le SARS-CoV-2, bénéficiant également de recherches vétérinaires depuis 2015 environ.
Enfin, la notion de doute est développée dans le dernier chapitre. En effet, les vaccins se distinguent d’autres médicaments par leur visée préventive et non curative. Généralement, une personne malade acceptera de prendre un médicament pour guérir, même si celui-ci peut avoir des effets secondaires. Ces mêmes effets indésirables suscitent davantage de craintes lorsqu’il s’agit des vaccins, puisque le bénéfice peut quant à lui être incertain (peut-être que la personne vaccinée ne rencontrera jamais le pathogène dans sa vie) et invisible (certains vaccins étant tellement efficaces qu’aucun symptôme ne sera développé). Alors que les méthodes de test de l’efficacité des vaccins ainsi que celles de production sont désormais bien cadrées et qu’ils constituent parfois la seule façon de lutter contre une maladie, les vaccins continuent à cristalliser les peurs, notamment lorsqu’ils font l’objet d’une obligation vaccinale. Michel Morange n’occulte pas les diverses interrogations et tente d’y répondre factuellement lorsque c’est possible. Certaines questions peuvent en effet rester sans réponse pour le moment. C’est pour cela qu’il est indispensable de parler de sciences avec franchise dans les médias, d’éduquer les élèves à la méthode scientifique, de ne pas se laisser influencer par ceux qui parlent fort sans pour autant connaître leur sujet. C’est pour cela que toute recherche doit se faire selon les lois de l’éthique médicale.
Comme l’écrit Michel Morange, pour convaincre, il faut démonter les ressorts du doute par des explications claires. Avec cet ouvrage, vous aurez les clés en main pour vous faire votre propre opinion, éclairée.