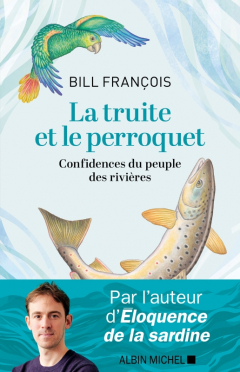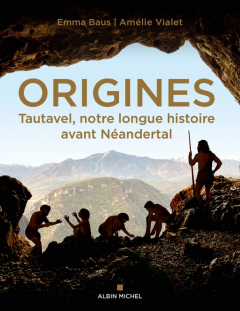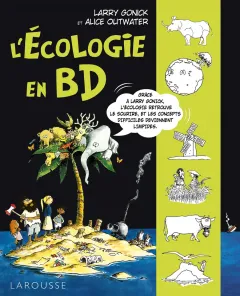Ce livre d’initiation à l’écologie est destiné à un public d’étudiants ou à toute personne intéressée par une meilleure compréhension de l’écologie scientifique, aussi bien dans ses concepts théoriques que dans ses applications dans les crises environnementales contemporaines.
Ce titre a été publié dans sa première version aux États-Unis en 1996. Larry Gonick est un auteur de BD de vulgarisation scientifique, ancien enseignant de mathématiques à Harvard. Alice Outwater est une ingénieure en environnement ayant réalisé des travaux sur le nettoyage des ports et les eaux usées. Le texte a été traduit et mis à jour par Vanina Pialot, éditrice spécialisée en vulgarisation scientifique.
L’écologie en BD propose un tour d’horizon assez complet de l’écologie scientifique. Le livre est organisé en 14 chapitres, dont voici quelques exemples : (1) les forêts et l’eau, (2) plus de cycles, (6) à table, (7) du chasseur-cueilleur au cultivateur, (10) les réseaux d’énergie. À la lecture, il semble ressortir deux grandes parties, assez différentes dans leur contenu et dans leur traitement : les six premiers chapitres traitent plutôt d’écologie fondamentale tandis que les huit chapitres suivants sont très centrés sur l’humanité et son rapport à l’environnement. Les liens entre ces deux parties sont malheureusement ténus.
D’autres livres grand public d’initiation à l’écologie viennent à l’esprit en particulier le très riche Guide illustré de l’écologie de Bernard Fischesser et Marie-France Dupuis-Tate (Delachaux et Niestlé), ou l’Écologie pour les nuls écrit par l’écologue universitaire, Franck Courchamp. Même s’ils sont très différents (textes plus récents, illustrations réalistes et basées sur des situations réelles, exemples européens), ces deux livres, comme L’écologie en BD, ont la volonté de présenter de façon accessible les fondamentaux de l’écologie.
Dans la première partie, après une introduction sur l’exemple classique de l’effondrement des populations de l’Île de Pâques (dont les auteurs précisent que les hypothèses explicatives sont controversées), on trouvera un enchaînement de définitions et de concepts parfois très théoriques, abordés en deux ou trois phrases (capacité biotique, production primaire nette, écotone, population, mutualisme, etc.), sans fil conducteur et manquant souvent de mise en contexte et de discussion (selon les cas : histoire du concept, mise en évidence expérimentale, exemples permettant de comprendre, conséquences aux différentes échelles). Ainsi la spéciation est traitée en deux tiers de page, un tiers pour la spéciation allopatrique (75 mots), et un tiers pour la spéciation sympatrique (50 mots). On peut penser qu’il s’agit d’un rappel utile pour un lecteur qui a déjà vu ces concepts, mais on peut douter qu’un néophyte s’y retrouve. Il est surprenant de constater que la biologie de la conservation (aire protégée, réintroductions, etc.) soit quasiment absente.
Alors même que le support bande dessinée est extrêmement précieux pour développer une narration, une complémentarité texte-image ou multiplier les statuts pédagogiques de l’image (illustration du texte, figure légendée décrivant une structure, schéma fonctionnel légendé d’un processus, etc.), on reste ici un peu sur sa faim. Les dessins permettent surtout d’aérer le texte (dense et généreux en concepts, mots-clefs) et d’apporter le plus souvent un clin d’œil humoristique. Quelques figures fonctionnelles permettent de mieux comprendre certains concepts (par exemple les schémas légendés classiques des cycles de l’eau, du carbone, de l’azote et du phosphore).
Dans la deuxième partie (à partir du chapitre 7), on s’intéresse à l’humanité dans toutes les composantes de ses impacts environnementaux : chasseur-cueilleur versus invention de l’agriculture, migrations-guerres-colonisations, pandémie, consommation de ressources et besoin en énergie, gaspillages, etc. On aborde au fil de l’eau la destruction et la fragmentation des habitats, la surchasse et la surpêche, les pollutions ou le changement climatique. Le support BD est dans cette partie mieux exploité avec davantage de narration et de continuité dans le propos. Néanmoins, les sujets sont abordés de façon assez discontinue : nulle part ne se trouvent rassemblés la liste des causes de la crise de la biodiversité, le lien entre le cycle du carbone global et le changement climatique, les conséquences sur les populations humaines de la crise de la biodiversité, etc.
S’agissant d’un livre qui se veut pédagogique on aurait aimé des bilans, des synthèses et des mises en relation entre les parties. Des liens entre les questions de biodiversité, de climat et d’agriculture auraient facilité une vision globale. Il manque certains thèmes qui sont aujourd’hui largement dans le débat et qui sont ici peu ou pas abordés. Cela tient peut-être à l’ancienneté de la première version du texte. On regrette notamment : l’efficacité des aires protégées (et l’inclusion des populations humaines), la notion de services écosystémiques (avec des exemples), l’importance de la diversification végétale comme support à l’agroécologie, l’ingénierie écologique ou plus généralement les solutions basées sur la nature (la phytoépuration des eaux usées fait p. 187 l’objet d’un dessin peu compréhensible).
Ce livre pourra permettre au grand public de découvrir les bases scientifiques de l’écologie, susciter la réflexion et faire sentir l’importance dans notre quotidien de ses enjeux. Toutefois, on ne peut considérer qu’il s’agisse là d’un support actualisé et suffisant qui accorderait assez de place aux résultats, solutions et perspectives contemporaines en matière d’écologie.