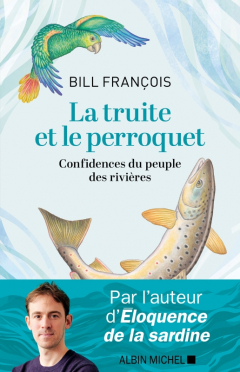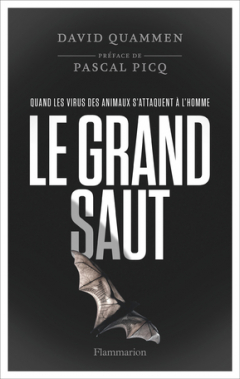La pandémie de Covid-19 a provoqué un intérêt pour diverses œuvres en lien avec les maladies infectieuses, qu’il s’agisse du roman La peste de Camus, du film Contagion de Soderbergh ou encore du jeu de société Pandémie. C’est dans ce contexte que paraît Le grand saut, traduction en français du livre Spillover. Animal infections and the next human pandemic écrit par David Quammen en 2012.
Tout commence en Australie, en 1994, avec la mort inexpliquée de plusieurs chevaux et de deux hommes. Il aura fallu plusieurs années, et la mobilisation de nombreuses femmes et hommes pour comprendre l’origine de ces drames. En l’occurence, un saut d’espèce du virus Hendra, depuis les chauve-souris du genre Pteropus vers les chevaux. Puis un second saut, cette fois des chevaux aux humains. Plusieurs années plus tard, David Quammen, écrivain scientifique, s’est rendu sur place dans la banlieue de Brisbane. Il a ainsi pu interroger certains des protagonistes de cette triste histoire : famille, éleveurs équins, vétérinaires… C’est à travers ces témoignages et les publications scientifiques sur le virus Hendra que Quammen présente l’écologie du virus Hendra.
Chacun des huit autres chapitres reprend une forme à peu près similaire, entre enquête sur le terrain, entretiens avec des chercheuses et chercheurs, et synthèse de résultats scientifiques. Une question en particulier anime Quammen, aussi bien pour Hendra que pour la maladie à virus Ebola, le SRAS, la maladie de Lyme ou le sida : d’où viennent ces maladies ? Quels sont les organismes qui servent de réservoirs aux virus et bactéries responsables de ces pathologies ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que trouver les espèces qui hébergent ces pathogènes nécessite des moyens et du temps. La méthode est généralement la suivante : prélever du sang, de l’urine ou des fécès provenant du plus grand nombre possible d’êtres vivants (essentiellement des Mammifères) autour de la zone d’émergence de la maladie. C’est ainsi que l’on a pu identifier les chimpanzés comme réservoirs hôtes du VIH-1, les macaques à longue queue comme porteurs de Plasmodium knowlesi (un des agents responsables du paludisme) et de nombreuses espèces de chauve-souris1 comme hébergeant des virus (SARS-CoV, Hendra, Marburg, virus de la rage, Nipah…).
C’est d’ailleurs l’un des constats marquants du livre : la plupart des maladies émergentes sont causées par des virus, en particulier des virus à ARN : Marburg (1967), Lassa (1969), Ebola (1976), VIH-1 (1983), VIH-2 (1986), Hendra (1994), Nipah (1998), virus du Nil occidental (1999), SRAS-CoV (2003)…
L’accélération de la fréquence à laquelle émergent ces maladies s’explique au moins en partie par les contacts de plus en plus nombreux des populations humaines avec les animaux. Il peut s’agir d’animaux sauvages et plus fréquemment en contact avec les humains du fait de la destruction de leur habitat (exemple des chimpanzés et d’Ebola, ou encore des macaques à longue queue et du paludisme à P. knowlesi), mais aussi d’animaux élevés (comme pour les civettes et le SRAS) ou domestiqués (les chevaux et Hendra).
[Les maladies émergentes] ne nous tombent pas dessus, elles résultent de certaines de nos interventions. Elles sont à la convergence de deux types de crise, dont la première est écologique, et la seconde, médicale. [...] Les pressions et les bouleversements écologiques exercés par l'homme sont tels que les agents pathogènes sont de plus en plus proches des populations humaines. Par ailleurs, nos technologies et nos modes de vie contribuent à les diffuser plus loin et plus vite.
Au final, Le grand saut est un livre à destination du grand public, très accessible, et permettant de donner quelques bases d’épidémiologie et de microbiologie. Cependant, l’essentiel des idées majeures sur les agents pathogènes, leur origine et leur mode de propagation se trouvent dès les premiers chapitres. Les autres chapitres ne présentent alors que des variations autour d’un même thème. Néanmoins, le format de l’enquête, associé à la plume de Quammen, permettent de maintenir l’intérêt en suivant l’auteur dans des forêts vidées de leurs gorilles par Ebola ou sur un toit branlant du Bengladesh pour capturer des chauves-souris avant le lever du jour… Pour finir, signalons que la traduction contient quelques imprécisions, la plupart ne portant par préjudice à la compréhension du texte, à l’exception notable de la traduction de bug par « insecte » ou « bestiole » au lieu de « microbe » (p. 47-49, 209 et 211).
Sur le même sujet
- Comment émergent et ré-émergent les nouveaux virus humains ?
- La Fondation pour la recherche sur la biodiversité a publié en mai 2020 un document sur les liens entre Covid-19 et biodiversité. En réalité, les 22 questions/réponses de ce rapport traitent de manière plus large la question des zoonoses, leurs liens avec la biodiversité ainsi qu'avec les activités anthropiques.